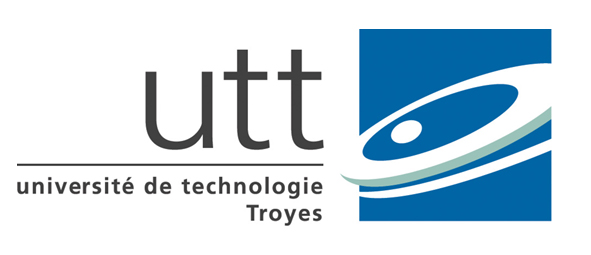Les dommages que pourraient susciter le changement climatique, les dégradations de la biosphère mais également les techniques transformant les êtres humains ne peuvent être considérés comme des risques, par définition limités dans leur portée et indemnisables. Il s’agit de dommages pouvant remettre en cause le déploiement des sociétés humaines. C’est l’idée maîtresse qui structure cet article et qui invite à s’interroger sur la capacité d’action comme sur les conséquences de l’utilisation des techniques et technologies humaines.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.
Les références originales de ce texte sont : Dominique Bourg, Pierre-Benoît Joly et Alain Kaufmann, « Du risque à la menace Penser la catastrophe», Presses Universitaires de France. Collection L’écologie en questions 2013.
Reproduit avec l’autorisation de l’auteur.
Ce texte, ainsi que d’autres publications peuvent être visionnés sur le site de l’université de technologie de Troyes
Dommages transcendantaux
Les dommages que pourrait susciter le changement climatique, difficilement séparable des autres dégradations du système biosphère, et ceux plutôt immatériels qui pourraient découler de l’essor des anthropotechniques, sont généralement conçus comme des risques, si nombreux soient-ils. J’essaierai de montrer que le risque ne constitue pas pour les dégradations de la biosphère une catégorie adéquate, qu’il est même en l’occurrence contre-productif. La raison en est que le risque, notion moderne s’il en est, requiert un double paradigme, individualiste et monétaire. Or, les dommages en question ne sauraient être appréhendés en termes uniquement individuels et monétaires. Ils concernent en effet nos conditions naturelles d’existence, par définition collectives, dont l’altération pourrait aller jusqu’à remettre en cause le déploiement même des sociétés humaines, monnaies comprises. Dans ce cas, nous aurions à faire à une forme transcendantale de dommage, située sur un plan méta, conditionnant notre quotidien dans ces aspects matériels et relationnels.
La situation est plus complexe en ce qui concerne les anthropotechniques. Certains de leurs développements pourraient affecter l’idée que nous nous faisons de notre propre humanité et concerne également une forme de dommage transcendantal ; d’où la place que nous leur accordons ici. Par ailleurs, l’un de problèmes majeurs qu’occasionnerait leur développement est on ne peut plus classique, puisqu’il s’agit de l’intensification des inégalités sociales, laquelle non plus ne relève pas à proprement parler d’un risque.
Risques et modernité
Depuis quelques décennies, rares sont désormais les phénomènes qui semblent encore pouvoir échapper au paradigme du risque. La société du risque d’Ulrich Beck a probablement joué un rôle déterminant dans cette invasion. Or, le risque ne relève pas uniquement d’une approche par le calcul de probabilités associant aléa et vulnérabilité. Il emporte avec lui un prisme individualiste et monétaire. Il n’a aucun sens en dehors d’une société individualiste, au sens de Louis Dumont, valorisant l’individu et son parcours économique, cherchant à promouvoir juridiquement la liberté et l’enrichissement personnels. Le risque est inhérent au développement de la société moderne, impulsé tant par la philosophie de contrat et les revendications dont elle est porteuse que par l’économie de marché naissante. Il est solidaire de la construction et de l’essor des sociétés libérales et industrielles. Dés lors étendre quasi absolument cette catégorie, c’est probablement le meilleur moyen se s’interdire d’identifier des phénomènes nouveaux, échappant à la logique libérale et individualiste, et surtout la remettant ne serait-ce que partiellement en cause.
Le risque ne peut concerner que des dommages touchant un nombre restreint d’individus, au sens propre ou figuré (des individus physiques, mais également une ville ou un pays par opposition à d’autres), et renvoie à une logique d’indemnisation et de compensation monétaire. Qu’il s’agisse de risques commerciaux, maritimes, afférents à la variété des dangers naturels ou au trafic automobile, de risques sociaux (accidents professionnels, malade, retraites), etc., le risque ne peut affecter qu’un ou des individus, qu’une partie d’un groupe considéré, mais jamais le groupe en tant que tel, ce faute de quoi évidemment les mécanismes de mutualisation et de compensation pécuniaires ne sauraient fonctionner. Ces mécanismes eux-mêmes seraient par ailleurs privés de sens si la monnaie n’apparaissait comme une forme d’équivalent absolu. Le risque et les mécanismes qui lui sont associés ne peuvent donc concerner qu’indirectement la société en totalité, donc ni globalement, ni dans ses fondements. Sans assurances et systèmes de mutualisation du risque, le volume même des activités d’une société donnée ne pourrait en effet que se réduire du fait du renoncement des individus à nombre d’activités les exposant à des dommages difficilement supportables par des individus privés de toute espèce de filet assuranciel. Si par exemple la proposition de retraités croit fortement, si le nombre de chômeur excède un certain seuil, si donc la part des individus concernés devient trop importante, les mécanismes associés au risque deviennent hors-jeu et c’est l’ensemble du système social qui entre en crise.
En revanche, dans une société traditionnelle, et holiste, marquée par de fortes solidarités familiales ou claniques, cantonnant des échanges monétaires, leur soustrayant d’importants secteurs, à commencer par la terre, le risque et la logique assurantielle ne sauraient avoir de place. Les individus et les aléas de leur existences connaissent d’autres formes de protection, plus organiques, relevant d’une solidarité structurelle du groupe. Et dans le cadre de la modernité, c’est l’État lui-même qui ne souscrit pas à une logique assurantielle, précisément parce qu’il incarne la totalité.
Certes le mot « risque » peut connaître des acceptions plus larges, dépassant le sens évoqué. La réalisation de ces risques en un autre sens englobe alors l’ensemble de la société. Lorsqu’une société entre par exemple en guerre ou dans une crise économique profonde, voire dans des dynamiques d’effondrement telles que Jared Diamond (2006) a pu les étudier, c’est l’ensemble de la société qui est affecté par la réalisation du risque, même si le degré de souffrance n’est pas également réparti au sein de la population. Le point commun avec le sens premier du mot « risque » est l’idée d’une rupture violente, d’un avant et d’un après dans la vie des individus concernés. Le risque et sa réalisation renvoient ainsi derechef à un phénomène exceptionnel par opposition à un standard plus large. Qu’il s’agisse d’une société s’effondrant au milieu d’autres qui perdurent, ou de sociétés entrant en guerre pour un temps à l’issue duquel elles connaîtront de nouveau la paix, le retour ultérieur à la normalité, fût-elle différente de l’ère ayant précédé la crise, caractérise ces ruptures. Or, nous le verrons, les dommages matériels affectant la biosphère pourraient définitivement modifier nos conditions d’existence, sans retour possible au statu quo ante.
Biosphère et non-pertinence de la catégorie du risque
Il est difficile d’envisager le changement climatique en cours en l’isolant des autres dégradations du système biosphère. J’entends ici par biosphère l’enveloppe de viabilité qui conditionne l’existence même de l’humanité, et qui comporte la biosphère, au sens restreint de l’ensemble des espèces vivantes, l’hydrosphère, la pédosphère, ainsi que les couches superficielles de l’atmosphère et de la lithosphère (McNeill,2010). Or, l’essor exponentiel des activités et de la démographie humaines depuis les années cinquante a profondément dégradé la biosphère. L’essentiel de ces dégradations renvoie aux neuf domaines suivants : le changement climatique, le taux d’érosion de la biodiversité, le cycle de l’azote, la déplétion de l’ozone stratosphérique, l’acidification des océans, l’usage de l’eau douce et celui des sols, la quantité et la qualité de la pollution chimique et enfin, l’impact des aérosols atmosphériques. Pour trois de ces domaines, nous avons d’ores et déjà dépassé le seuil de dangerosité : le climat ayant le cycle du carbone, l’état de la biodiversité conditionne la résilience au changement climatique, lequel pèsera lourd à son tour sur le rythme d’érosion des espèces, lequel dépendra encore de l’augmentation du taux d’acidité des océans, du niveau de pollution des sols, etc.
C’est pourquoi je préfère évoquer ici un faisceau de dégradations – un processus bien engagé -, et non telle dégradation particulière de la biosphère, le climat ou tout autre paramètre.
Il n’est pas ici question de survenue de quelques aléas, mais de mécanismes cyndinogènes en cours, qu’il nous serait possible de réduire, mais que nous ne cherchons qu’à atténuer, et que nous pourrions même, malheureusement, amplifier, compte tenu de la double inertie, sociale et naturelle, des phénomènes concernés (AIE, 2011 ; PNUE, 2012 ;UNEP,2011).Pour autant que poursuivre les processus en cours de dégradation conduit immanquablement à des dommages pour l’humanité, il est de toute évidence inexact de parler de risque. L’enjeu cumulé ultime de ces dégradations, que l’on retienne l’une ou l’autre de ces deux entrées principales, le climat ou la biodiversité, n’est autre que l’atteinte d’un point de basculement à partir duquel les capacités d’adaptation du genre humain seraient résolument dépassées ; ce qui signifierait notamment une chue de capacités mondiales de production alimentaire et, par voie de conséquence, un effondrement des effectifs démographiques de l’espèce.
Dans un mode de plus 4°C, les limites à l’adaptation humaine sont probablement dépassées dans de nombreuses parties du monde, alors que celles propre aux systèmes naturels sont largement dépassées dans le monde entier. En conséquence, les services écosystémiques dont dépendent les modes de vie humains ne pourraient être préservés. Même si des études ont suggéré que l’adaptation devrait être possible dans quelques aires pour les systèmes humains, de telles études n’ont généralement pas pris en compte la perte de service écosystémique. (Warren,2011)
Si on considère l’entrée biodiversité (Barnosky,2012) l’horizon n’est guère plus dégagé :
Ici nous récapitulons les preuves selon lesquelles des transitions critiques à une échelle planétaire se sont déjà produites au sein de la biosphère, quoique rarement, et que désormais les hommes sont en train de provoquer une transition comparable, qui pourrait faire basculer rapidement et de manière irréversible la Terre vers un état jamais expérimenté par le genre humain.
Autrement dit, nous aurions désormais le choix vers des difficultés que nous pourrons encore assumer et des dommages que nous ne serons plus en mesure de supporter. Si tel devait être le cas, nous aurions créé des conditions hautement défavorables à l’épanouissement du genre humain et ce sans possibilité de retour au statu quo ante.
Essayons de décrire l’écoumène qui pourrait nous échoir, pour autant qu’on puisse le faire, en se plaçant dans la pire des hypothèses. Commençons par un rappel d’autres paramètres, ceux touchant la démographie et l’ensemble des ressources. Nous serons probablement neuf milliards aux alentours de 2050 sur une planète qui commence en certaines régions à connaître des problèmes de disponibilité d’eau douce ; une planète qui, si on considère les ressources non conventionnelles, plus difficilement accessibles, connaît encore d’abondantes ressources fossiles ; une planète, dont les ressources minérales facilement exploitables sont grosso modo en voie d’épuisement, ce qui signifie qu’il conviendra d’aller chercher des minéraux de plus en plus profondément, avec souvent un taux de concentration moindre, et donc à grands renforts d’énergie fossile (Bihouix et Guillebon,2010)…L’écoumène sera voué à un rétrécissement continu, du fait de la montée du niveau des mers dont rien ne peut nous assurer la régularité, et en raison du changement du régime de pluies. L’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes rendra l’écoumène plus hostile. En cas de basculement des écosystèmes, et d’effondrement des services écologiques, l’hostilité accrue pourrait se convertir en impossibilité radicale, plus ou moins étendue, d’habiter. Si l’on devait en arriver là, outre l’effondrement démographique, c’est l’ensemble de nos institutions – politiques, démocratiques, juridiques, économiques et financières – qui s’effondrerait. Et l’on ne saurait non plus parler d’un retour à l’état de nature, parce que l’état en question présuppose une nature accueillante et source d’abondance qui aurait précisément disparu. Ce n’est toutefois pas le lieu d’analyser l’absurdité métaphysique de cette fiction, à l’origine de l’individualisme moderne et de nos problèmes actuels au moins pour partie.
Il est clair qu’une pareille situation ne saurait en rien relever du risque. L’enjeu ne se situe pas ici sur le plan des risques, fussent-ils nucléaires et afférant à l’exploitation des centrales du même nom. Il s’agirait ici de la condition aux possibilités mêmes d’épanouissement de l’espèce humaine, de la condition au développement de ses potentialités. Il en irait de la disparition de la condition de possibilité naturelle au déploiement des sociétés humaines, à savoir l’état actuel de la biosphère. Il n’y a donc pas là un bien public pareil à d’autres, mais un bien qui conditionne la possibilité de tous les autres, naturels ou sociaux, public ou privés. C’est d’ailleurs pourquoi nous parlons d’un dommage transcendantal. Le problème n’est pas ici individuel et aucun individu ne peut émettre quelque prétention vis-à-vis d’un tel bien public. Ce bien est l’indisponible par excellence (Bourg et Papaux, 2011). Nous sommes ici sur le plan du genre humain en tant que tel, même si des sociétés et des individus peuvent tirer dans un premier temps des bénéfices des dégradations en cours. Par ailleurs, l’approche monétaire et en termes de compensation n’a ici aucun sens. On peut bien envisager de compenser, d’une certaine manière, la disparition de ses parents pour un enfant, mais il ne saurait y avoir de compensation pour une dégradation pérenne de ces conditions naturelles d’existence, et a fortiori pour la disparition du genre humain ; ce qui n’a pas totalement échappé à Beck.
Non seulement la notion de risque est inadéquate, mais encore est elle dangereuse. Elle rabat en premier lieu ce qui conditionne, le transcendantal, sur le plan du conditionné, des phénomènes expérimentés par le genre humain. En second lieu, l’invasion de la catégorie du risque maniée par les techniques de communication jette le doute sur tout, et au premier chef sur les grands enjeux biosphériques, de sorte que toute vérité s’estompe sauf la césure vraiment solide, individualiste et monétaire, entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Et c’est évidemment ce qui se passe dans le climat notamment. (Conway & Oreskes,2010 ; Foucart,2010 ; Huet,2010 ; Godard,2010 ; Decroly, Gemenne et Zaccaï,2012). Et l’on s’est évidemment empressé d’objecter par exemple à l’étude citée (Barnosky,2012) sur le basculement des écosystèmes que le scénario décrit n’était pas certain, ce qui est juste, dans un sens ou dans l’autre d’ailleurs, pour le pire comme pour le meilleur. Mais là n’est précisément pas le problème : c’est la trajectoire même de notre civilisation qui est éminemment problématique et qui, au-delà de toutes les supputations possibles, nous conduit immanquablement à des dommages globaux. Le risque fait croire que l’humanité pourrait s’extraire de l’impasse dans laquelle elle s’enfonce par de petits calculs économiques et/ou par quelque deus ex machina technologique.
L’invasion du risque est plus largement un des aspects de la néolibéralisation en cours des esprits, dont le trait le plus marquant est l’affaiblissement extraordinaire des États (Klein, 2010). Des États qui sont en voie de marginalisation, l’espace réservé à la chose publique semblant chaque jour plus étroit. Des États qui ne peuvent plus battre monnaie et deviennent les otages des banques, des agences de notation et donc d’investisseurs privés. Des États qui n’exercent aucun contrôle sur les entreprises multinationales, qui ont laissé certaines d’entre elles jouir d’un monopole quasi mondial et qui se sont laissé entraîner dans un dumping fiscal ruinant les finances publiques. De même que nous avons rabattu les États sur le plan des individus et autre agents économiques, nous rabattons les enjeux biosphériques sur le plan des risques.
Quid dans ces conditions du principe de précaution, dont on prétend généralement qu’il concerne notamment les risques environnementaux globaux ? En réalité, il est fort à craindre qu’il n’y ait pas grand-chose à attendre en matière biosphérique du principe de précaution. Le principe ne vaut que sur un territoire donné et a grand peine à s’imposer à l’échelle internationale. Et surtout, le principe ne vaut que là où le droit peut s’imposer, à savoir, face à un problème circonscrit, un risque précisément, afférent à une technique particulière, ce qui n’est pas le cas avec le carbone et plus généralement l’ensemble des flux sous-jacents à nos activités économiques. On ne saurait attendre d’un seul principe de droit positif un changement emportant tout une civilisation, fût-ce pour en empêcher la dérive.
Anthropotechniques et dommages transcendantaux
Nous entendons par anthropotechniques des techniques visant à transformer des êtres humains en intervenant sur leur corps et leur psychisme, voire en leur modifiant sensiblement, mais sans finalité médicale (Goffette,2006, p69). Les problèmes sont ici d’une nature tout différente de ceux que l’on vient d’aborder. On peut considérer un dommage environnemental comme un mal, et comme un bien le fait de l’éviter. En revanche, celui qui recourt à une intervention anthropotechnique cherche un mieux ou à éviter ce qui lui apparaît comme un moindre bien ; il cherche à optimiser ce qui lui apparaît sous-optimal. Et quel que soit au final le choix de l’individu en question, et les interprétations qui l’inspirent, il n’a pas d’incidence directe sur autrui, mais généralement une incidence indirecte.
Considérons deux cas de figure très différents et en premier lieu le cas d’individus désirant modifier leur apparence physique, non de façon vestimentaire ou apparentée, mais en recourant à une ou des anthropotechniques pour par exemple allonger ses jambes ou accroître sa carrure. Envisageons le cas cocasse d’un désir d’oreilles d’éléphant (Freitas, 2007). Comment appréhender la réalisation de ce genre de désir, de cette volonté d’amélioration de son apparence physique, non pour la personne en question, mais d’un point de vue social ? Contentons-nous de remarquer qu’il est alors très difficile de trouver des critères spécifiques d’appréciation, des critères autres que ceux permettant de juger l’apparence effrayante tomberaient sous le chef d’accusation de trouble à l’ordre publique.
Ne pourrait-on pas cependant dénoncer dans ce genre d’opération une atteinte à la dignité humaine ? Ce ne me semble pas pouvoir être le cas car cette notion permet plutôt de protéger des personnes contre l’agissement néfaste d’autres. On pourrait alors évoquer le cas d’une auto-atteinte à la dignité, par la personne elle-même, sur elle-même. Mais attention, cette notion permet aussi de protéger la dignité et l’humanité d’un individu, quelle que soit la situation ou l’apparence qui peuvent lui échoir. On peut à cet égard évoquer le film Eléphant Man mettant précisément en scène le regard deshumanisant porté par autrui sur un individu souffrant d’une malformation congénitale ostentatoire.
Considérons un usage des anthropotechniques qui porterait autrement à conséquences. Qu’adviendrait-il si le scénario imagé par le généticien américain Lee Silver (1997) venait à se réaliser ? On connait la croyance très répandue aux USA selon laquelle nos gènes déterminent directement nos comportements. D’où la tentation de nombreux parents de doter leur enfant d’un capital génétique amélioré, via les anthropotechniques, avec une attente de résultat tant sur le plan physique que comportemental. On peut supposer que ces parents, qui auront investi, à tous les sens du terme, dans le capital génétique de leur enfant, n’auront qu’une crainte : qu’il s’unisse avec quelqu’un qui n’aurait pas bénéficié d’un pareil enrichissement, lequel serait alors complètement perdu. Lee Silver propose de résoudre le problème en suggérant qu’on intervienne sur les molécules de liaison entre spermatozoïdes et ovules, de tel sorte que tous les enfants qui auraient bénéficié d’un enrichissement génétique ne seraient plus interféconds avec ceux qui n’en auraient pas bénéficié. Le Wasp originaire de la côte Est et plutôt fortuné ne risquerait plus de connaître une union féconde avec une personne au génome standard. La satisfaction de cette demande, rendue possible par la technologie disponible et le marché aboutirait à une altération profonde de notre situation profonde et symbolique. Depuis la disparition de l’homo sapiens neandertalensis, il existe en effet un genre humain avec une seule espèce humaine. Avec l’hypothèse envisagée, nous aboutirions, au bout de quelques générations, à l’existence de deux espèces au sein du genre humain. Deux espèces dont on peut imaginer qu’elles n’entretiendraient pas nécessairement des relations harmonieuses. Cet état de choses n’affecterait rien moins que l’idée que nous nous faisons de notre humanité. Elle nous paraît en effet inséparable de son caractère indivisible et universel. Or, nous nous retrouverions avec deux espèces conçues en outre de façon hiérarchique. Nous sortirions du cercle constitué par l’affirmation de l’unité du genre humain, sur laquelle reposent les droits humains comme le principe de l’égalité des citoyens devant la loi. Un héritage que l’on peut considérer comme une forme symbolique et idéelle du bien public. Pour autant ledit bien serait profondément altéré, il y aurait là un dommage symbolique, touchant un concept clé de notre édifice social. On retrouve ici cette hubris moderne aux yeux de laquelle l’altération d’un bien public pour le bénéfice d’un petit nombre ne semble même pas problématique.
Quoi qu’il en soit, là encore, il n’est guère loisible de parler de risque. Comme dans le cas de la biosphère, on part d’une situation, l’autorisation d’opérations anthropotechniques qui conduisent à une altération de notre idée même d’humanité, et à une situation lourde de violences possibles entre les deux espèces en question. Il n’est pas question d’aléa, mais d’un développement d’un état de fait dont les conséquences finissent par concerner la société dans sa globalité. Toute autre est la situation des oreilles d’éléphant : on reste dans une situation individuelle, et le risque existe bel et bien pour l’individu de ne plus supporter la modification de son apparence ardemment souhaitée antérieurement.
Nous avons parlé d’un dommage symbolique, mais est-on fondé à parler ici aussi d’un dommage transcendantal ? Non, pour deux raisons. La première est qu’un retour en arrière est possible, il suffirait de rendre les individus du groupe ayant donné lieu à spéciation à nouveau interféconds par les mêmes anthropotechniques. En outre, le bien public en question, d’origine européenne, n’est pas universellement reconnu comme un bien public.
Poursuivons la réflexion sur l’intérêt et les conséquences d’une amélioration des êtres humains via les anthropotechniques, en interrogeant quelques-unes des affirmations charriées par le discours transhumaniste. À des fins problématiques, je partirai de la différence entre condition et nature humaines, ce qui devrait nous permettre d’aborder à nouveau la question du transcendantal et d’évaluer certaines des prétentions du transhumanisme et une amélioration de la condition humaine.
La prétention cardinale de ce courant de pensée est celle à une forme non d’immortalité, mais d’amoralité, avec un allongement de nos durées de vie plus ou moins important. Un allongement significatif de l’espérance de vie moyenne (mais attention les transhumanistes raisonnent en termes d’intervention technique, et donc sur des individus) nous ferait sortir de la nature humaine en ce sens que tous les êtres humains, même dans les conditions optimales, ne sauraient dépasser une certaine durée de vie, située entre un siècle et un siècle et demi. Plus généralement le vieillissement et la mort constituent un trait commun à toutes espèces, un trait systémique, dépendant donc d’une grande multiplicité de facteurs, qu’on ne saurait surmonter en bricolant quelques gènes. Sans quoi, l’évolution aurait déjà produit quelques mutants immortels (Swynghedauw et Toussaint, 2010). Imaginons toutefois que nous soyons parvenus à allonger notre durée d’existence de façon significative, aurions-nous pour autant transformé et même amélioré la condition humaine ? Non et pour de multiples raisons. En premier lieu, le trait le plus prégnant de la condition humaine est notre finitude, laquelle commence par le fait d’être né ; nous pourrions ne pas être nés, ou être nés autrement. Ce par rapport à quoi nos techniques n’ont aucune prise. Un autre trait de la finitude qui nous échoit est de devoir choisir, et donc de devoir renoncer à ceux des choix que nous n’avons pas retenus. Compte tenu du coût des anthropotechniques, nous ne saurions à sept milliards tous en bénéficier. Choisir de prolonger la vie de quelques-uns, très certainement les plus riches, c’est encore accroître leur degré de prélèvement sur les ressources et les capacités de charge du système biosphère. Un autre trait de notre finitude est la saveur des premières fois et la lassitude que finit par susciter à l’impossibilité où il se trouve de mourir. Nous pourrions lutter contre l’ennui et annulant techniquement notre mémoire, ce qui serait alors une façon de mourir, de mourir en tant que moi inséparable d’un vécu et d’une mémoire. Force est de constater primo que nous ne saurions sortir de la condition humaine comme nous pourrions éventuellement nous affranchir de tel aspect particulier de notre cahier des charges physiologique ; secundo, il n’y aurait pas d’amélioration générale de la condition humaine, mais au mieux et de façon discutable, une amélioration partielle de la condition de certains individus, au détriment de celle d’autres individus.
Certes la différence que nous faisons entre condition et nature humaines est contestable. La différence des sexes est par exemple à la fois une donnée biologique structurante et un trait tout aussi essentiel à la condition humaine. Il semble bien toutefois que nous approchions avec la condition humaine d’un plan transcendantal auquel, à la différence de celle de la biosphère, il ne nous est pas même possible de porter atteinte.
Même si les anthropotechniques connaissent un nouvel essor, le problème général qu’elles posent n’a rien de nouveau, à savoir l’accroissement des inégalités. Les anthropotechniques ne devraient pas en effet déroger à la règle que semble prévaloir depuis qu’une partie de l’humanité est parvenue à exploiter technologiquement et significativement les énergies fossiles : une quête de la puissance qui ne cesse d’accroître l’écart entre les plus nantis et les plus démunis. Comparativement à une hache, par exemple, une tronçonneuse augmente la productivité du travail d’un facteur allant de 100 à 1000. Ce qui nous permet de comprendre qu’avant les années 1820, les écarts de richesse matérielle entre les nations n’aient probablement pas dépassé, ou alors de peu, un rapport de 1 à 2 (Bairoch, 1997). Le PIB par habitant atteint au Qatar 85 600$, 79 600$ au Luxembourg et 46 300$ aux USA pour 200$ au Zimbabwe et 400$ au Liberia. Le Qatar est ainsi en moyenne 428 fois plus riche que le Zimbabwe, alors qu’à la fin du XVIIIe siècle, avant l’envolée de la révolution industrielle, il aurait été impossible de trouver une nation deux fois plus riche qu’une autre. Le présent et plus encore l’avenir proche, semblent aux antipodes de l’espérance des modernes, de Bacon à Hegel aussi bien que Marx : la maîtresse technique de la nature leur paraissait receler la promesse d’une reconnaissance universelle des hommes dans leur égale dignité. La dialectique hégélienne du maître et de l’esclave, celui-ci finissant par l’emporter grâce à son travail, cristallisa un temps cette espérance. Or, cette dynamique est visiblement inopérante à l’échelle de la planète. Au lieu de la reconnaissance de l’égale dignité de tous rêvée par Hegel, l’inégalité du monde nous conduit à une minorité de plus en plus performante et riche, dominant une masse peu productive durablement pauvre. On ne voit ni comment ni pourquoi les anthropotechniques échapperaient à cette dynamique. Et là encore, il ne s’agit pas à proprement parler d’un risque, mais de l’effet quasi assuré d’une tendance générale et impérieuse, qui seule une régulation publique extrêmement forte pourrait contrecarrer.
*
Au fondement tant des dégradations de la biosphère que de la volonté de bouleverser la condition humaine, se trouve la croyance occidentale et moderne en la puissance sans limites de nos technologies. Dans le premier cas, elle nous conduit à parier les conditions naturelles d’existence et même la survie du genre humain, et dans le second derechef, pour autant que le transhumanisme contribue à nous détourner du souci de notre survie collective.
D’autres, notamment Jean-Baptiste Fressoz et Dominique Pestre, ont cherché à montrer que la société du risque ne pouvait caractériser une seconde modernité réflexive, pour autant que la modernité libérale et industrielle avait, dès ses origines, cherché à acculturer les populations à une prise de risques croissante dont elle était parfaitement consciente. La vague néolibérale, à laquelle ressortit à mes yeux l’inflation de la notion du risque, tend désormais à nous faire croire que notre mise en danger absolue n’est qu’un risque, à l’image de ceux que tout bon capitaine d’industrie doit prendre.
NB : Pour les références de l’article se référer à l’ouvrage p124-126
Par : Dominique BOURG
Source : Université de Technologie de Troyes