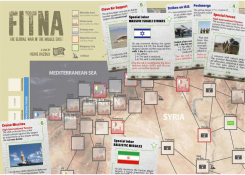Cet article s’intéresse aux notions de guerre et de paix et, au-delà de leurs dimensions juridiques ou constitutionnelles, à leur empreinte sur les consciences et dans les perceptions. Il s’interroge en particulier sur la dichotomie paix-guerre, conception westphalienne de la conflictualité interétatique, ou encore sur l’usage paradoxal du mot guerre et sur sa signification au sein de nos sociétés.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.
Les références originales de ce texte sont: « Guerre ou paix contre guerre et paix, ou Janus retrouvé… » de Patrick Bouhet.
Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être consultés sur le numéro 196 de Défense, publié par l’Union-IHEDN.
Il y a un peu plus de 400 ans, en Bohême, commence l’une des plus terribles guerres dont l’Europe ait conservé le souvenir, la guerre de Trente ans. Semblant à première vue opposer les Catholiques et les Protestants au sein du Saint-Empire Romain Germanique, il s’avère qu’en réalité elle permet l’affirmation de certaines puissances et la lutte pour des intérêts bien plus temporels que spirituels. C’est ainsi, que le très catholique royaume de France, dirigé qui plus est par un cardinal, Richelieu, s’allie à une Suède déclarée protectrice des Protestants. Laissant l’Europe centrale exsangue, la guerre se termine non par la victoire éclatante d’un ou plusieurs belligérants mais par de longues tractations diplomatiques qui aboutissent aux traités de Münster et Osnabrück en 1648.
La Paix de Westphalie marque une évolution majeure dans l’histoire des guerres en ce qu’il y est mis fin dans les antichambres, salles de réunion, voire de bal, plutôt que sur un champ de bataille. Mais elle marque aussi l’apparition d’un nouvel ordre des choses dans le cadre duquel la dichotomie paix/guerre est d’autant plus marquée que des actes bilatéraux ou multilatéraux marquent clairement le passage de l’un à l’autre entre des États-nations. La guerre ne s’est donc pas seulement épuisée d’elle-même, comme un feu qui s’éteint progressivement, mais est considérée comme finie car la paix est déclarée.
Cependant, une première question reste ouverte. Si le passage de la guerre à la paix est clairement défini, celui de la paix à la guerre, non limitée à ses définitions d’ordre juridique, ne l’est pas autant. La concurrence plus ou moins déclarée, dans des domaines aussi différents que l’accès aux matières premières, à des marchés ou encore à de nouveaux territoires ; l’emploi de la violence ou de la coercition sous toute ses formes, par une action plus ou moins directe, ne permettent plus de définir un état de guerre, larvée ou déclarée. D’un côté, le terme de guerre a perdu de sa spécificité : ne parle-t-on pas très (trop) souvent de guerre économique ? De l’autre, il n’est plus employé pour décrire l’emploi des forces armées y compris dans des actions faisant appel à la violence tel que cela fut le cas, pour des raisons essentiellement juridiques en interne et diplomatiques en externe, dans le cadre de l’engagement français en Afghanistan entre 2001 et 2012.
La dichotomie paix/guerre : un accident dans l’histoire ?
Néanmoins, dans notre référentiel occidental, cet ordre des choses est profondément inscrit. Il existerait donc deux états exclusifs l’un de l’autre : la paix et la guerre. Suétone écrit au début du IIe siècle son oeuvre majeure conservée : La vie des douze Césars. Dans le Livre II, consacré à Auguste, après avoir rappelé ses origines, son parcours et son accession à l’ensemble des titulatures qui font de lui le véritable premier « empereur » romain, il indique : « le temple de Janus n’a été fermé que deux fois avant lui [Auguste] depuis la fondation de Rome : il le ferma trois fois dans un beaucoup plus petit espace de temps, grâce à la paix qu’il rétablit sur terre et sur mer… ». Si l’on accepte la date de 753 avant notre ère pour la fondation de la Ville, c’est donc bien peu pour une durée de 767 ans à la date de la mort d’Octave devenu Auguste.
La dichotomie paix/guerre pourrait donc apparaître comme un accident dans l’histoire, faisant du phénomène de retour à une période de concomitance ou de simultanéité des deux états, non une innovation, mais une forme de normalisation des relations conflictuelles où la paix ne serait plus qu’une pause proche de la logique de l’armistice en ce qu’elle permettrait de reconstituer ses forces en préparation d’une prochaine phase de conflit déclaré à venir et cela jusqu’à l’incontestable victoire d’un des belligérants. Pendant ce temps d’accalmie, la guerre serait poursuivie sous d’autres formes, par d’autres moyens, en une forme d’inversion de la célèbre formule de Clausewitz.
Ce phénomène est dénommé, notamment dans certains documents américains, de zone grise. Mais là encore la nouveauté est toute relative. En effet, la poursuite d’objectifs stratégiques par des moyens non militaires est documentée depuis les périodes les plus anciennes, profitant ou provocant des faiblesses chez un adversaire sans pour autant agir par la violence des armes. Il s’agirait même dans certaines cultures stratégiques de méthodes à privilégier afin de gagner une guerre dès avant le début des combats voire même sans avoir à en conduire. Sun Tzu apparaît comme l’un des auteurs majeurs de cette école, ce qui permet de démontrer et l’ancienneté et la permanence de conceptions non westphalienne de la conflictualité interétatique. C’est ce qui fait par ailleurs l’une des différences fondamentales dans le contenu des principaux textes des écoles stratégiques asiatique et occidentale : la première s’intéresse beaucoup à la phase qui précède le conflit armé afin d’être en position de l’emporter dès avant le début des opérations quitte à n’avoir pas à les entreprendre ; la seconde se penche en premier lieu sur la conduite des opérations et la recherche de la victoire dans le combat.
Donc, déstabiliser le concurrent ou l’adversaire en son sein même, jouer la division entre les différents éléments, ethniques, sociaux ou idéologiques constituant un État, agir contre les intérêts économiques ou isoler, par l’action diplomatique, ne sont pas des modes d’actions nouveaux. La diversité des acteurs qui pourrait apparaître comme une nouveauté est elle aussi toute relative. En effet, il ne faut pas oublier que l’expansion économique et territoriale des principales puissances coloniales européennes, notamment les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou la France a été engagée sur la base d’initiatives d’ordre privé, impliquant même la création de forces militaires tout aussi privées. Le lien avec les États n’est, par-contre, dans la majorité des cas, indiscutable, impliquant de facto la possibilité de la poursuite d’objectifs stratégiques nationaux par des entités non-étatiques. Ce qui implique aussi, que même en dehors des périodes guerrières, des objectifs stratégiques y compris militaires peuvent être poursuivis sans pour autant que le sentiment de risque majeur ou même de conflit tangible ne soit partagé.
Le sentiment d‘être en état de guerre
Et cet aspect de perception générale de la situation et du contexte qui nous ramène à l’exemple d’Auguste et des guerres de la Rome antique. La population romaine a-t-elle eu la perception d’être constamment en état de guerre ? Au moins symboliquement : oui. Le nombre restreint des fermetures des portes du temple de Janus semble en être la démonstration. La véritable question est de savoir si cette perception a été réelle dans l’ensemble politique et territorial romain ou si le sentiment de menace n’a été ressenti que par les habitants, romains ou non, des frontières ou espaces périphériques.
La réponse s’agissant de Rome a pu être apportée, pour les périodes les mieux documentées, par les historiens. Pour revenir à notre époque, la question reste posée. La France, sur des bases constitutionnelles et juridiques se considère en état de paix. La population bien que marquée par les attentats sur le sol national et, dans une moindre mesure, par les pertes heureusement relativement peu fréquentes subies en opérations extérieures se sent-elle en guerre ? Il semblerait que non.
Mais en réalité cette perception n’est pas limitée à la période la plus récente. Si l’on considère que 1962 marque la fin du sentiment aigu d’engagement dans des opérations militaires, il nous est possible de dire que c’est la période qui s’étend de la fin des événements, devenus guerre d’Algérie, qui doit être examinée. En prenant comme point de départ la Seconde guerre mondiale, les Français ont dû percevoir ainsi, sans aucun doute, être en guerre de 1939 à 1962. Mais depuis, malgré le nombre croissant d’opérations extérieures (OPEX) mais aussi les attaques perpétrées sur le territoire national, le sentiment général n’est pas à la guerre. Mais le sentiment particulier des populations présentes sur les théâtres d’opérations et aussi celui des troupes engagées sont naturellement différents. D’où une différence sensible de perception des relations entre les États et du niveau de menace.
La France, tout comme Rome, serait-elle dans état permanent de guerre ou plutôt de paix relative ? Elle est dans tous les cas dans une situation d’engagement militaire quasi-permanent en particulier en Afrique subsaharienne où se sont déroulées 44 % des OPEX depuis 1962. Cependant, le dénombrement en est difficile tant leur nature peut être différente : les unes durent des mois voire des années et engagent des milliers d’hommes et les moyens correspondant, d’autres à peine quelques heures. Néanmoins, le Général Thorette a dénombré à l’occasion des travaux pour la constitution d’un monument commémoratif des OPEX, 126 opérations entre 1963 et 2011 inclus. Soit pour une période de 48 ans une moyenne de 2,6. Nous sommes donc loin d’une période de paix déclarée et réelle sans pour autant que la guerre le soit non plus. Outre les questions d’ordre juridique, cela peut s’expliquer en grande partie par la difficulté de définir les contours d’adversaires qui ne sont, la plupart du temps, pas des États. Ou encore par la retenue, souvent bienvenue, qui refuse de désigner un groupe entier ou une population dans son ensemble comme l’ennemi. Mais ne pas désigner l’adversaire, en dehors du fait que cela ne permet pas de penser la guerre à conduire en tant qu’acte de violence visant à en faire céder la volonté, ne permet pas non plus de mobiliser les moyens et volontés au-delà de ce que demande un niveau de défense minimum. Si cela évite une certaine surréaction face à la menace réelle voire une montée progressive aux extrêmes, que certains adversaires cherchent sciemment à provoquer, cela empêche aussi de voir dans une certaine mesure la réalité du quotidien des populations concernées et des troupes engagées. En effet, cette réalité est celle du combat et d’une compréhension du phénomène guerre inscrit dans le réel et non dans la norme. D’où un certain sentiment d’incompréhension voire d’abandon et un grand risque de fracture.
Le paradoxe de l‘usage du mot guerre
Les modes d’action qui semblent être privilégiés par certains de nos concurrents ou adversaires déclarés favorise l’emploi de moyens visant notre société, notre économie ou notre système de valeur en complément ou en substitution de l’action armée. Pour autant la réaction peut paraître faible aux uns ou proportionnée aux autres. La vraie question, comme à la veille de la Seconde Guerre mondiale, est celle de la perception de la véritable dangerosité de la menace et de l’existence d’une volonté commune suffisamment forte pour y faire face à temps. Car même si nous pensons être en paix, certains peuvent penser être d’ores et déjà en guerre contre nous. Et le nombre d’opérations dans lequel sont engagées les forces françaises tend à conduire certains à penser que nous sommes aussi déjà en guerre contre eux. La question qui se pose alors est celle de la dualité paix/guerre et de la perception que l’on peut avoir de l’usage de la violence. Apparaît alors un paradoxe étonnant : alors que l’on se refuse à utiliser le terme pour des zones de combat ouvert, on ne se prive pas de le faire s’agissant d’autres secteurs de l’activité humaine. C’est ainsi qu’en politique, on assiste depuis quelques années à une brutalisation du discours, voire des actes physiques. Faut-il donc que la guerre soit terriblement proche pour que l’on ose la nommer ?
Par : Patrick BOUHET
Source : Union-IHEDN/Revue Défense